LA CHARPENTE A PORTIQUE ET MANSARDS
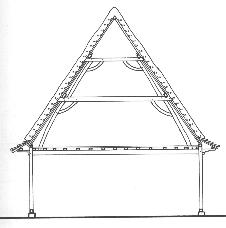 Il
nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique
de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également
dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,
répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on
a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,
de Dunkerque à Caen.
Il
nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique
de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également
dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,
répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on
a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,
de Dunkerque à Caen.
Cependant, on peut également le trouver dans des bâtiments
maçonnés, et notamment dans les maisons urbaines en brique. La
parenté évidente qui existe entre le contreventement de ce type
de comble et le pan de bois de type flamand à décharge assemblée
à mi-bois atteste bien la primitive origine commune des combles à
portique et de la construction en pan de bois.
Ce comble à portique présente une structure classique
en pays germaniques (Allemagne, Suisse alémanique, Alsace) et la coïncidence
exacte existant entre la localisation des charpentes et les secteurs de parler
flamand montre bien le caractère culturel des techniques de construction.
Le Pas-de-Calais, pour lequel le parler flamand a disparu depuis
fort longtemps, malgré la permanence d'une toponymie flamingante jusqu'à
la vallée de la Canche, est, en effet, dépourvu totalement de
spécimens de constructions à portique, mais comporte au contraire,
des charpentes "à la française" et à cruck.
La structure à portique utilise, tout comme la charpente
"à la française", le principe de la triangulation
basse par entrait. Selon la conception germanique du comble, le charpentier
conçoit un portique composé de deux jambes de force surmontées
d'un entrait retroussé. Faciles à monter à l'épaule
sur les poutres du plancher, ces portiques sont immédiatement coiffés
par les pannes qui reposent sur les extrémités des entraits. Un
deuxième portique peut venir prendre place au-dessus du premier, lorsque
le comble est haut. Or, il faut signaler qu'une des caractéristiques
des toitures du Nord-Pas de Calais réside dans la forte pente des rampants
antérieurs à 1914. Conçues initialement pour le chaume,
ces toitures s'inclinent toujours selon une pente d'au moins 50°.
On peut associer au dispositif à portique le souci des
concepteurs d'économiser les bois longs nécessaires à la
réalisation des arbalétriers : on constate que la charpente à
deux portiques ne nécessite que quatre jambes de force de 2,50 mètres
faciles à trouver, alors qu'une ferme latine, dans un même comble,
aurait nécessité deux arbalétriers d'environ sept mètres
de longueur, de fourniture beaucoup plus difficile.
Outre l'économie de bois, cette structure à portique
permet également d'économiser les moyens de levage, puisque, à
partir d'un portique monté à l'épaule, les charpentiers
peuvent s'échafauder pour dresser le second portique, toujours à
l'épaule. Une ferme latine aurait nécessité le moyen d'une
chèvre de levage, dont les charpentiers de village flamands devaient
chercher à éviter l'usage.
Toujours à l'instar de la conception du comble à
l'allemande, le comble à portique flamand n'utilise pas de pièce
de faîtage ; les chevrons sont donc assemblés par paire, à
mi-bois, et, autre détail caractéristique, le conduit de feu de
la cheminée n'a pas besoin de se déporter, comme dans les autres
régions françaises, pour éviter l'axe du faîtage
: la maison flamande et, par le jeu d'une ancienne influence, celle de différents
secteurs du Pas-de-Calais, frappe par sa souche bien centrée entre les
deux versants. L'absence de faîtage n'a toutefois pas que des avantages
techniques : les portiques doivent également se passer de poinçon
et surtout de liens de contreventement des fermes. La nécessité
mécanique de cette fonction amène le charpentier flamand à
utiliser un contreventement rampant d'un principe similaire à celui du
contreventement du colombage par les décharges obliques. C'est ainsi
que l'on observe de curieuses planches fortes disposées obliquement en
sous-face des chevrons, assurant un médiocre contreventement.
Pratiques et économiques à monter ces charpentes
flamandes "pré-françaises" souffrent par contre
de faiblesses de structure, dues aux nombreux raccords dans les pièces
de bois entraînant des articulations, affaiblissant les fermes et insuffisantes
pour la stabilité longitudinale du bâtiment, notamment face à
la grande prise au vent qu'offrent les impressionnants combles flamands.
Ces caractéristiques techniques ont peut-être contribué
à expliquer, outre l'irréversible poussée culturelle des
processus de francisation de la culture flamande, les transformations progressives
de la charpente de comble flamande. C'est ainsi que, dès le XIXe siècle,
certaines charpentes importantes commencent à comporter faîtages
et liens tandis que les fermes, même modestes, adoptent dès le
début du XXe siècle l'arbalétrier d'une seule pièce,
bien latin dans son principe.
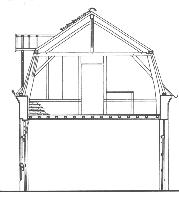 Malgré
cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de
la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé
: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est
la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre
de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe
du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,
on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde
est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier
la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.
Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement
propre à l'habitation, bien dégagé grâce à
un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée
par un terrasson en pente plus faible.
Malgré
cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de
la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé
: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est
la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre
de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe
du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,
on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde
est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier
la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.
Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement
propre à l'habitation, bien dégagé grâce à
un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée
par un terrasson en pente plus faible.
Le besoin de loger une main-d'œuvre ouvrière rurale
très tôt née en Flandre explique l'apparition précoce
de ce système constructif dont l'architecte Mansart fut probablement
le promoteur davantage que le concepteur.
Tout comme les solivages à entrevous de brique et les charpentes
ogivales inspirées de la structure à cruck, les combles à
la Mansart témoignent d'une influence durable des modèles constructifs
populaires sur les conceptions savantes de l'art de bâtir.
Source : L'architecture rurale française
- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)
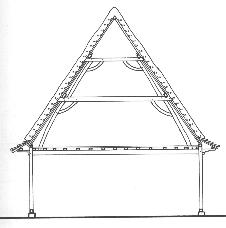 Il
nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique
de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également
dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,
répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on
a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,
de Dunkerque à Caen.
Il
nous reste à envisager le troisième type bien caractéristique
de charpente de comble connu dans le département du Nord, mais également
dans toute la Flandre. Il s'adapte à des constructions en pan de bois,
répondant toujours à ces bâtiments longs et bas que l'on
a évoqués précédemment pour tout le nord de la France,
de Dunkerque à Caen.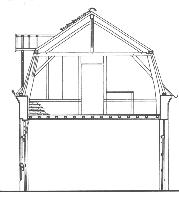 Malgré
cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de
la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé
: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est
la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre
de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe
du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,
on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde
est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier
la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.
Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement
propre à l'habitation, bien dégagé grâce à
un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée
par un terrasson en pente plus faible.
Malgré
cette mutation technique et culturelle, un aspect caractéristique de
la construction flamande n'a pas disparu, lui, mais s'est remarquablement diffusé
: il s'agit du comble "à la Mansart". La Flandre est
la région de France qui compte encore aujourd'hui le plus grand nombre
de toitures populaires selon ce tracé. Or, si l'on observe le principe
du comble à portique, déjà attesté au Moyen Age,
on réalise immédiatement combien la construction d'une mansarde
est aisée à partir d'un tel système. Il suffit de modifier
la pente des chevrons au-dessus des portiques pour obtenir cette charpente caractéristique.
Cette configuration permet ainsi d'obtenir un premier niveau d'occupation particulièrement
propre à l'habitation, bien dégagé grâce à
un brisis fort pentu, surmonté d'une petite toiture constituée
par un terrasson en pente plus faible.