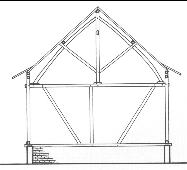LA CHARPENTE "A CRUCK"
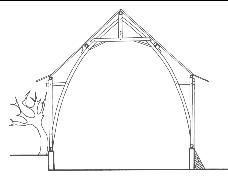 Rares
sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt
de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,
à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux
plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence
attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,
Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés
en Flandre belge.
Rares
sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt
de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,
à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux
plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence
attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,
Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés
en Flandre belge.
Là encore, pour ces charpentes très spectaculaires
que sont les crucks et leurs dérivés, s'est posée la question
d'une éventuelle diffusion Grande-Bretagne-Flandre ou, au contraire,
la question d'une apparition spontanée de ces principes de construction
en différents lieux.
Quoi qu'il en soit, on se trouve en présence d'une des
conceptions typiquement populaires de la charpente en bois. A ce titre, aucun
traité de charpenterie, aucune école savante d'enseignement du
bâtiment n'a pris en considération ce principe de structure porteuse.
Il s'agit pourtant là d'une conception extrêmement élaborée,
nécessitant un soin tout particulier dans le choix de l'approvisionnement
en bois, dans le traçage des bois courbes, particulièrement difficiles
à équarrir et à ligner. Nous sommes ici, loin d'un art
populaire fruste, qui aurait été supplanté par le savoir-faire
de techniciens plus exigeants. Mais voyons tout d'abord en quoi consiste ce
mode de construction.
Le recours à la charpente à cruck marque la volonté
du constructeur de réserver à l'intérieur d'un bâtiment
une circulation longitudinale optimisée, notamment pour des usages agricoles,
au rez-de-chaussée comme sous le comble. Pour cela, le principe de la
triangulation par entrait bas est abandonné ; il est toutefois plausible
que le système à cruck ait historiquement préexisté
au système triangulé, aucun document ne nous permettant actuellement
de conclure.
L'entrait bas se révèle en effet gênant pour
le stockage des gerbes, car il constitue une barre horizontale : on a, de toute
façon, constaté que la distribution des bâtiments en pan
de bois est toujours transversale en région Nord-Pas-de-Calais. La présence
de traxanes est fort fréquente, pour des raisons de renforcement de la
structure de base : malgré cela, il n'est pas rare d'observer des granges
déformées de façon spectaculaire.
On comprendra donc à quel point l'utilisation des fermes
à cruck dans les structures en pan de bois constitue une audace constructive,
pas toujours bien maîtrisée, d'ailleurs, par les charpentiers.
La charpente à cruck comporte également, environ tous les quatre
mètres, ce que l'on peut appeler des fermes, c'est-à-dire des
plans verticaux, perpendiculaires à l'axe du bâtiment, servant
de relais dans le support des pannes. Autant le comble à triangulation
par entrait marque bien la séparation entre comble et rez-de-chaussée
(même dans le cas d'un comble à surcroît), autant la ferme
à cruck tend à créer un seul volume, libre des entraves
que constituent entrait et plancher.
Le principe mécanique de la charpente à cruck le
plus achevé est fondé sur la recherche d'une transmission des
poussées exercées par les charges de la toiture directement vers
le sol ; pour cela, le cruck utilise un arbalétrier monoxyle, cintré,
qui, partant du faîtage, devient jambe de force et rejoint directement
le sol. Avec ce principe, on a donc évité de faire participer
les murs, toujours faibles au regard des poussées de la toiture vers
l'extérieur, à la statique de la charpente de comble. Les murs
deviennent pratiquement de simples rideaux, tandis que la résultante
des poussées s'exerce, dans l'idéal, à la verticale, sur
des dés de pierre, ou même sur la sole.
Dans la pratique, il est bien rare que la courbe épousée
par la pièce monoxyle, élaborée de manière empirique,
permette d'éviter totalement des poussées sur les murs extérieurs.
Ces contraintes incontrôlées par le charpentier peuvent entraîner
des déformations spectaculaires, voire catastrophiques.
Comme on peut le voir, la construction à cruck constitue
dans le domaine de l'architecture préindustrielle un des rares cas dans
lesquels la statique à moyen terme du bâtiment fasse l'objet d'un
pari. En effet, il semble bien qu'en choisissant ce principe l'on accepte le
risque de déformation de la structure, qu'on n'imputera pas à
la plus ou moins grande compétence du charpentier : celui-ci, rappelons-le,
ne peut se permettre d'être mauvais, tant sont fortes la concurrence et
l'exigence de la communauté villageoise. Il semble bien, dans ce cas,
que le besoin d'une meilleure distribution l'ait emporté sur les risques
liés à la faiblesse du système constructif.
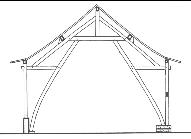 Une
version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est
réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes
de force se dédoublent.
Une
version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est
réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes
de force se dédoublent.
Une troisième version des charpentes à cruck caractérise
très directement la petite région de l'Ardrésis. Cette
structure utilise le principe de l'arbalétrier monoxyle cintré,
significatif des charpentes à cruck les plus achevées ; mais là
où les fermes de l'Ardrésis déroutent considérablement
le chercheur, c'est dans le fait qu'elles n'utilisent pas du tout les avantages
de cette dernière technique (bonne circulation dans le bâtiment).
Au contraire, le cruck, qui constitue à lui seul un système constructif,
est ici doublé à l'aide des deux autres systèmes de charpente
que connaissent les constructions vernaculaires en France, pour la première
fois réunies dans une invraisemblable version syncrétique de la
charpente rurale ! C'est ainsi qu'apparaissent simultanément poteau sous
faîtage et triangulation à deux niveaux : par entrait bas, comme
dans le cas des fermes "à la française", et par
sole, comme pour les traxanes.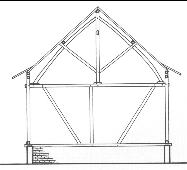
Ces structures étonnamment redondantes apparaissent bien
attestées au XVIIIe siècle et figurent tant dans les bâtiments
agricoles que dans les bâtiments d'habitation. Ces charpentes frappent
par la complexité de leur mise en œuvre, ainsi que par les faibles
avantages qu'elles autorisent pour la circulation. Il est probable que, à
l'instar des autres exemples français s'apparentant à la construction
à cruck, ce soit la conception avec pièce cintrée monoxyle
qui ait disparu la première : on perçoit bien comment ces fermes-refends
se sont facilement transformées en simples traxanes.
Source : L'architecture rurale française
- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)
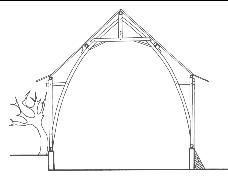 Rares
sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt
de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,
à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux
plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence
attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,
Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés
en Flandre belge.
Rares
sont les principes de construction en bois qui ont provoqué autant d'intérêt
de la part des chercheurs que les charpentes baptisées, en Grande-Bretagne,
à cruck. Bien connues des Anglais, qui en ont recensé chez eux
plusieurs milliers de spécimens, ces charpentes ont vu leur présence
attestée également en France dans le Centre (Corrèze, Limousin,
Quercy) ainsi qu'en Bretagne. Quelques spécimens sont signalés
en Flandre belge.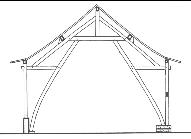 Une
version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est
réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes
de force se dédoublent.
Une
version plus complexe, et probablement plus efficace mécaniquement, est
réalisée par une ferme dans laquelle arbalétriers et jambes
de force se dédoublent.