LA CHARPENTE "A LA FRANCAISE"
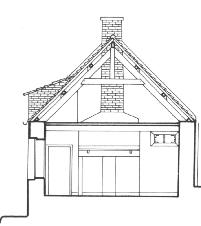 Nous
retiendrons le qualificatif "à la française"
pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble
des régions françaises à des modèles mécaniquement
plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre
et de l'Ardrésis.
Nous
retiendrons le qualificatif "à la française"
pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble
des régions françaises à des modèles mécaniquement
plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre
et de l'Ardrésis.
Les combles que nous appelons "à la française"
sont caractérisés par la présence de fermes triangulées
selon la conception mécanique la plus achevée : entrait bas, arbalétriers
longs, poinçon long. Les charpentiers contemporains, au savoir technique
standardisé, réalisent toujours ce modèle et le baptisent
"charpente à ferme latine".
L'utilisation quasi générale de cette structure
dans les régions de tradition latine confirme effectivement la pertinence
d'une telle attribution culturelle.
Il apparaîtra d'autant plus efficace d'opposer ce type de
structure à celle qu'utilisèrent les charpentiers flamands jusqu'au
milieu du XIXe siècle. La conception latine des combles se révèle
donc avoir supplanté historiquement les pratiques flamandes de l'art
de la charpenterie, tout comme elle a supplanté aux XIXe et XXe siècles
les pratiques lorraines (poteau central), alsaciennes (portique sans faîtage)
et toutes les autres manifestations originales de construction en bois, spécifiques
de particularismes régionaux. Une éventuelle itinérance
des charpentiers est-elle à l'origine de cette diffusion technique ?
Aucun document ne peut jusqu'à ce jour l'attester pour des régions,
tel le nord de la France, peu connues pour la mobilité de leur main-d'œuvre.
Quoi qu'il en soit, la force technologique des charpentes "à
la française" réside très vraisemblablement dans
le recours à un faîtage de bois emmanché dans le tenon des
poinçons et muni de liens de contreventement. Ces dispositions, qu'ignorent
systématiquement les charpentiers flamands, allemands et anglais jusqu'au
XIXe siècle, sont par contre présentes dans la charpenterie vernaculaire
de la plupart des régions françaises dès le XVIe siècle.
Elles permettent en particulier une bonne tenue des bâtiments
face au déversement longitudinal et, malgré les efforts plus importants
demandés au cours du levage, donnent aux bâtiments une meilleure
conservation dans le temps.
Les charpentes "à la française"
prédominent largement dans tous les secteurs de parler picard, y compris
dans les zones aux toponymes flamingants du Pas-de-Calais dans lesquels le parler
flamand n'a laissé aucune trace dans les mémoires. Dans tous les
cas, les charpentes "à la française" sont systématiquement
associées au pan de bois de type picard (décharge interrompant
les colombes).
Source : L'architecture rurale française
- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)
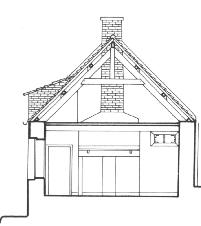 Nous
retiendrons le qualificatif "à la française"
pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble
des régions françaises à des modèles mécaniquement
plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre
et de l'Ardrésis.
Nous
retiendrons le qualificatif "à la française"
pour opposer une certaine structure de comble très courante dans l'ensemble
des régions françaises à des modèles mécaniquement
plus originaux que l'on rencontre dans les constructions anciennes de Flandre
et de l'Ardrésis.