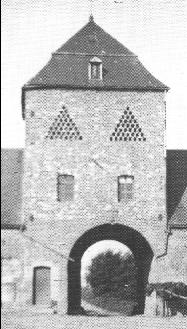 La
colombophilie est un des traits culturels spécifiques des régions
du nord.
La
colombophilie est un des traits culturels spécifiques des régions
du nord.
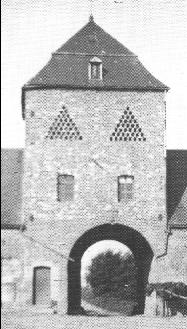 La
colombophilie est un des traits culturels spécifiques des régions
du nord.
La
colombophilie est un des traits culturels spécifiques des régions
du nord.
On sait que l'élevage des pigeons, sous l'ancien régime, était un privilège de la noblesse mais que celle-ci ne se livrait pas aux courses et rallies qui caractérisent le sport colombophile. La colombe représente un symbole dans la vie religieuse, mais aussi dans le domaine de la puissance et de la suzeraineté, ce qui entraînait la présence d'un pigeonnier dans chaque abbaye, chaque château, chaque cense importante dépendant d'une seigneurie.
Avec la Révolution, le droit d'élever des pigeons se vulgarise, mais ne se traduit pas par des constructions particulièrement importantes, comme l'étaient les bâtiments spécialisés préexistants. Ceux-ci étaient des colombiers "à pied" construits en matériaux durables : généralement en brique ou en pierre, rarement en pan de bois.
Si on trouve des bâtiments édifiés sur le
plan circulaire ou polygonal, la plupart le son sur un plan proche du carré.
Il ne semble pas que le colombier-porche intégré à une
cense soit aussi, originellement, un élément d'architecture seigneuriale
; comme ailleurs en France, il devait être l'attribut des roturiers. Le
modèle a pu servir lors de la construction, après la Révolution,
de censes bourgeoises, mais le pigeonnier est désormais de dimensions
plus réduites.
Dans les petites exploitations, le pigeonnier n'est qu'une cabane de bois posée sur deux poteaux au milieu de la cour de la ferme. Les pilotis peuvent aussi servir de support à un abri fermé.
On ne trouve pas dans les exploitations rurales disposant d'un
pigeonnier de personnes pratiquant la colombophilie. Né vers la fin du
XVIIIème siècle, le sport colombophile était, en France
comme en Belgique, surtout pratiqué par les habitants des agglomérations
urbaines.
Source : L'architecture rurale française
- la manufacture (ISBN 2-7377-0111.2)